
- Détails
- Clics : 1172
«L’espérance qui nous vient de la foi en Jésus c’est la capacité de voir une nouvelle réalité et d’agir en fonction de celle-ci. C’est attendre un monde différent et agir comme si nous y étions déjà.

- Détails
- Clics : 1377
9 mars 1522 : un repas qui fera date chez l'imprimeur Froschauer à Zurich
La liberté - il y a 500 ans et aujourd'hui
Le fameux repas de la saucisse de Froschauer, il y a exactement 500 ans, a eu lieu au printemps 1522, au début de la Réforme à Zurich. Il s'agissait de se libérer de la "contrainte de conscience". La liberté de conscience et de croyance étaient des préoccupations centrales de la Réforme. Elles ont donné des impulsions importantes à une conception globale de la liberté, y compris politique, économique et individuelle, telle qu'elle caractérise de manière variée la vie à Zurich aujourd'hui. Qui voudrait se passer de cette liberté ? Mais la liberté est aussi aujourd'hui une notion de plus en plus controversée : qu'est-ce qui distingue la liberté de l'arbitraire individuel, de la fin de toutes les certitudes - et du chaos ? Quelle liberté était en jeu en 1522 ?
Lien : ▶️
Quelques explications concerant le culte du 6 mars à Zürich
2022 marquera le 500e anniversaire de la consommation de saucisses pendant le Carême. Les réformés zurichois, les catholiques romains et les anabaptistes invitent à trois événements en commémoration de cet événement :
5 mars 2022 : congrès de reformiertbewegt et du centre de formation et de congrès Bienenberg, à la Wasserkirche de Zurich : Un jeûne comme je l'aime.
6 mars 2022 : culte œcuménique au Grossmünster de Zurich : invitation à toutes les paroisses à y participer !
16-18 septembre 2022 : Journée d'étude et de rencontre au monastère de Kappel (centre de formation et de congrès Bienenberg et hôtel de séminaire et maison de formation Kloster Kappel) : Le sel de la terre : être une Eglise libre

1522 fut une période de bouleversements à Zurich, comme dans toute l'Europe. Zwingli s'est engagé avec beaucoup d'autres à différents niveaux pour sa cause centrale : Libérer le message libérateur de la grâce de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ, afn qu'il puisse déployer sa force d'action ! Bien des choses étaient entrées dans l'Église, qui voilaient la voix libératrice de cet Évangile, l'alourdissaient et la rendaient souvent à peine compréhensible. C'est ainsi qu'ils voyaient les commandements de jeûne : Ceux qui devaient travailler dur physiquement (et c'était presque le cas de tout le monde à l'époque) ne pouvaient guère respecter les règles strictes du jeûne. Ils étaient une loi publique dans les semaines précédant Pâques, mais beaucoup devaient les rompre par nécessité et avaient alors l'impression de devenir ainsi coupables devant Dieu. Ils ne pouvaient plus entendre et comprendre qu'ils étaient appelés à la liberté par le Christ.
Zwingli n'était pas contre le jeûne. Que ceux qui le souhaitent le fassent. Mais il ne faut pas donner l'impression que celui qui ne respecte pas les règles met son salut en danger. C'est ainsi que Zwingli argumente dans l'écrit qui justife le fait de manger des saucisses pendant le Carême.
Que s'est-il passé ? Le 9 mars 1522, le premier dimanche du Carême, un groupe important s'est réuni chez l'imprimeur Christoph Froschauer, des ecclésiastiques autour de Zwingli, mais aussi des représentants des corporations d'artisans, des notables de la ville. Ils ont délibérément enfreint les règles du jeûne par provocation et ont mangé des saucisses. L'effet fut net et est considéré à Zurich comme un repère de la Réforme, comparable à l'affchage des thèses de Martin Luther à Wittenberg, quelques années auparavant.
Certains de ceux qui étaient assis à la table ont poursuivi ces préoccupations plus tard en tant que mouvement anabaptiste, en brisant un tabou similaire, le baptême d'adultes qui avaient déjà été baptisés lorsqu'ils étaient enfants. D'autres étaient peut-être à table à l'époque, qui plus tard ne suivirent plus le chemin de Zwingli et restèrent fdèles aux représentants de Rome. Mais à l'époque, ils étaient assis ensemble à la table et s'engageaient pour le même objectif.
C'est de cela qu'il s'agit dans les trois manifestations au cours desquelles les mennonites, les réformés zurichois et l'Eglise catholique romaine se penchent ensemble sur ce repas de saucisses d'il y a 500 ans.
Comme en 1522, nous reprenons le thème le premier dimanche du Carême, le 6 mars 2022, et nous célébrons un culte œcuménique au Grossmünster. Nous nous demanderons comment, en tant qu'Églises et communautés, nous avons répondu à ces préoccupations, même si c'est par des voies différentes. Que faut-il aujourd'hui pour que l'Évangile de Jésus-Christ puisse déployer son effcacité ? En tant qu'Églises, sommes- nous un obstacle à ce message ? Comment pouvons-nous être aujourd'hui des communautés dans lesquelles cet Évangile devient tangible ?

- Détails
- Clics : 1753
A Rocha Arts : la première édition d’un Chœur virtuel pour la création !
«Tu me réjouis par tes œuvres, ô Eternel ! Et je chante avec allégresse l’ouvrage de tes mains.» Psaume 92.5
Lien : ▶️

- Détails
- Clics : 1538

Rembrandt van Rijn, Le Retour du fils prodigue,
c. 1661–1669. 262 cm × 205 cm.
Musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, Russe
Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Luc 15/24 (TOB)
Comment réagir face à ceux qui nous ont blessé ?
Certaines personnes demandent justice y conçoivent le pardon comme étant équivalent à l’impunité. Avec cette attitude ils mettent en évidence la profonde rancune de ceux qui ont été victimes.
D’autres cherchent à fuir la réalité en ignorant le passé et en minimisant les dommages causés.
Jésus nous montre un chemin diffèrent :
la justice de Jésus ne cherche pas la récompense ni la vengeance, mais elle ne nie pas, n’ignore non plus les faits.
Comme le montre la parabole du fils prodigue dans l’évangile de Luc, la justice que Jésus pratique transforme la vie de nos offenseurs.
Il est compréhensible que les victimes réclament justice. Rembrandt le représente de façon magistrale dans son tableau Le Retour du Fils Prodigue dans l’attitude du fils ainé de la parabole.
Pourtant, Jésus nous invite à nous ouvrir à la possibilité de la réconciliation. Dieu est plus intéressé par la guérison des blessures causées que par l’obéissance stricte de la loi.
C’est de cette façon que le fils prodigue a pu obtenir le pardon et la possibilité d’un nouveau départ. La vie au lieu de la mort, c’est ce que trouve celui qui s’approche de Dieu. D’un point de vue divin, la justice ce n’est pas donner à l’offenseur ce qu’il mérite mais ce dont il a besoin : l’amour, la compassion et la miséricorde.
Aujourd’hui, alors que nous célébrons le Dimanche de la Paix, nous demandons à Dieu sa présence et le pouvoir de son Esprit pour répondre comme il le fait, aux offenses et aux blessures causées par les autres.
Seule cette attitude peut apporter la paix dont notre monde a tant besoin.
Shalom ! (Paix !)

voir sur le site de la Conférence mennonite mondiale
Ce message de la justice a été écrit en 2016. Ces paroles d’unité sont toujours aussi actuelles.

- Détails
- Clics : 1725
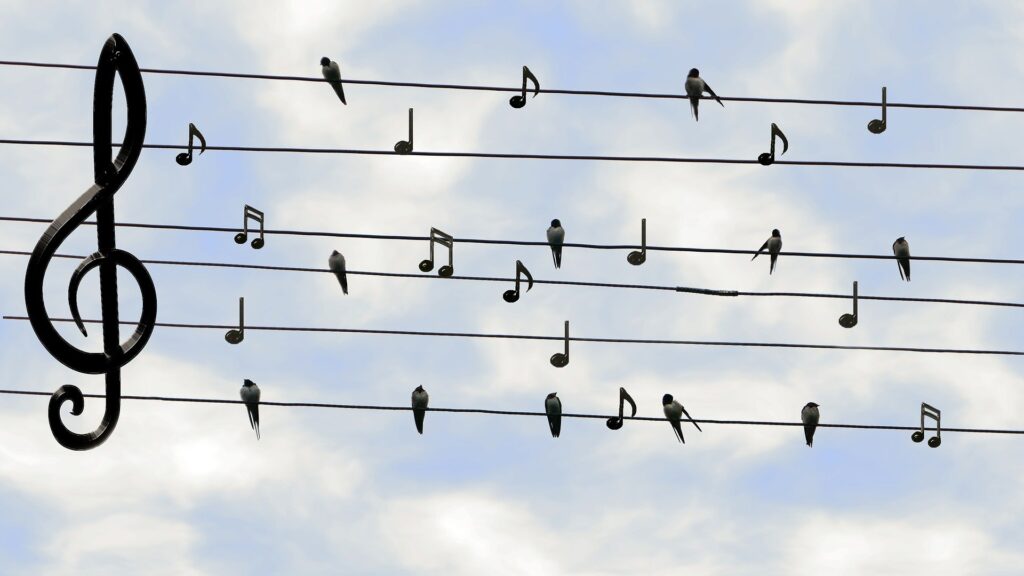
Nous aimons créer parce que nous sommes créés à l’image du Créateur.
Nous aimons Le louer parce qu’Il en est tellement digne – toute la création
chante déjà ses louanges !


